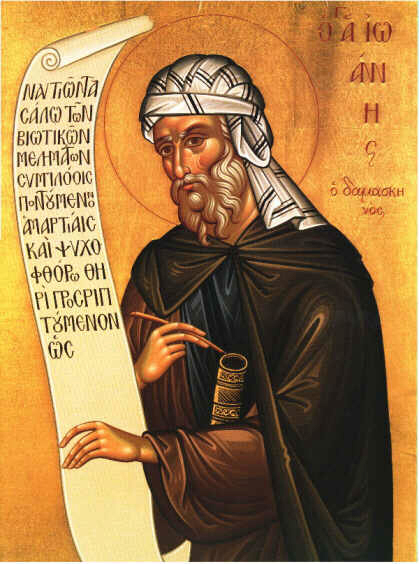Contra averroistas (2)
Mettant la main sur cette vidéo qui remet sur le tapis un sujet ouvert depuis bien longtemps sur ce blog sans avoir d’ailleurs jamais été fermé, nous ne pouvons résister à l’idée de renvoyer une fois de plus à cet article, et à celui-ci, et en outre, à partager à nouveau quelques réflexions.
1) Luc Ferry ne fait pas preuve de grande subtilité lorsqu’il entreprend de comprendre Averroès. Peut-être faut-il, pour s’en rendre compte, débrouiller deux questions distinctes, que Luc Ferry confond. D’une part, le Fasl al-maqâl est un écrit juridique, dans lequel le qâdî Averroès se charge de trancher du point de vue de la Loi religieuse, s’il convient ou non de pratiquer la philosophie, et à quelles conditions. D’autre part, se pose la question de savoir si les résultats de cette pratique de la philosophie sont compatibles avec les dogmes de l’Islam ou non. Ce sont deux questions différentes, et auxquelles Averroès ne donne pas la même importance : répondre à la première est l’enjeu du Fasl, tandis que la deuxième est éludée par lui, qui se contente d’affirmer en gros, que « nous-autres musulmans, nous savons qu’il n’y a pas de contradiction entre la vérité démontrée et la vérité révélée ».
2) Luc Ferry parle d’un « Islam des Lumières », d’une « démarche rationaliste », d’une « pénétration dans l’Islam du logos grec ». Il semble même que ces trois éléments n’en soient qu’un, à moins qu’ils ne soient différentes étapes d’un même processus… L’idée fantaisiste d’un Islam des Lumières du moins pour des oreilles un tant soit peu historiennes n’a pas à retenir notre attention. Concentrons-nous sur les deux autres éléments du discours de Ferry. Le Fasl al-maqâl relève-t-il d’une démarche rationaliste ? Ou mieux, en quel sens peut-on parler du rationalisme d’Averroès ? Ce sont là de vraies questions, et il ne s’agit pas seulement de lire, mais aussi de comprendre Averroès, et outre le grand faylasûf, de saisir l’esprit de l’Islam dont il est un fidèle.
3) a- Le Fasl, nous dit Ferry, et nous ne le contredirons pas, est un texte juridique. Et alors, il est évident qu’il est une expression rationnelle. Car le juriste use de la raison. Et Averroès le sait bien, qui va même justifier l’emploi du syllogisme démonstratif en remarquant que l’Islam des premiers siècles n’avait pas rechigné à l’idée d’intégrer le syllogisme juridique dans les études de droit religieux. Cependant, le droit dont ce texte se veut être un déploiement, n’est pas un droit fondé en raison, mais fondé sur la Révélation divine, dont Mohammed, le sceau des prophètes, a été l’instrument. Le Fasl al-maqâl est à la fois un texte religieux et un texte rationnel. Mais c’est la Loi (shar’) qui domine le discours, et non pas le logos grec (expression, soit dit en passant, tout à fait regrettable, mais bon passons), ni a fortiori, la « Raison » des Lumières. Voilà pour la question de la Loi et de la Raison, question fondamentale du point de vue d’Averroès, et dont il faut rappeler qu’elle est absente de la pensée chrétienne.
b- Comme nous le mentionnions plus haut. Averroès affirme que la Vérité révélée ne saurait être contraire à la vérité mise à jour par l’activité philosophique. Cette affirmation n’est pas justifiée par la raison philosophique, mais par un appel à la foi islamique. Bien des questions se posent à la lecture de ces instants rapides où Averroès aborde la question des rapports entre l’Islam et la Raison sous cet angle, bien que Luc Ferry soit content avec si peu. En quel sens peut-on dire qu’il n’y a pas de contradiction entre le shar’ et la philosophie (bien sûr, il faut préférer ce mot à celui, étriqué, de raison) ? Averroès affirme bien que « le vrai ne saurait être contraire au vrai ». Et il affirme que le Texte Saint doit pouvoir s’interpréter de telle façon qu’il dise la même chose que la philosophie. Du point de vue d’Averroès, il y a une équivalence parfaite entre l’enseignement contenu dans le Texte Saint et l’enseignement de la philosophie. Ainsi, on peut faire de lui un rationaliste si l’on veut, vu que la raison sera le critère mesurant ce à quoi il convient qu’un « homme de démonstration », considère comme vrai dans le domaine religieux même. A cet égard, le qualificatif de rationaliste est bien venu pour qualifier la doctrine averroïste, et toute son œuvre philosophique le confirme. Remarquons que l’on ne saurait dire la même chose au sujet des grands médiévaux chrétiens que mentionne Luc Ferry. Leurs œuvres sont rationnelles, mais certainement pas rationalistes, eux qui sont toujours théologiens avant d’être philosophes.
c) Il convient de noter en outre que ce rationalisme dont nous parlons ici concernant Averroès n’est pas un pur rationalisme. Qu’est-ce à dire ? Reconnaissons que le rapport posé par le philosophe de Cordoue entre la Philosophie et le Texte Saint n’est pas un rapport entre deux essences, mais bien une connexion qui s’est établie dans la pensée d’Averroès, et dont son œuvre fait foi. On sait qu’Averroès a tenté de dégager la philosophie d’Aristote de l’influence néo-platonicienne et religieuse islamique évidente chez ses prédécesseurs, en particulier chez Avicenne. Il reste que le Kashf et le Tahafut ne saurait être considérés comme des écrits purement philosophiques. On ne saurait les qualifier autrement, mais on ne peut pas plus oublier qu’ils répondent à des thématiques islamiques. On ne saurait donc considérer l’œuvre d’Averroès comme une œuvre entièrement faite de considérations exclusivement rationnelles. On ne peut pas non plus faire du penseur Averroès un penseur rationaliste au sens ou la religion chez lui découlerait de la seule raison. Selon le mécanisme que développe le Kashf, Dieu est la source de la vérité, qui inspire les prophètes et les philosophes. La source islamique d’une telle doctrine est-elle à démontrer ? Rappelons en tout cas, que de telles affirmations sont introuvables chez les Grecs.
d) Il importe également de ne pas considérer ce court texte sans prendre en compte l’œuvre averroïste dans son ensemble (ce que rappelait Brague dans son intervention). Une fois bien comprise la doctrine du Fasl, et sa prolongation dans le Kashf et le Tahafut, il reste possible et nécessaire de distinguer ce qui tient de la religion et ce qui tient de la philosophie. A moins que l’on tienne pour accordé que l’Islam n’enseigne rien de plus que la philosophie, et que la philosophie enseigne tout ce que dit l’Islam. L’œuvre averroïste est plus subtile que cela, mais il est vrai qu’elle amène à cette pensée. Mais une proclamation de pure rationalité suffit-elle à l’établir ? En philosophe en tout cas, on ne saurait l’accepter : on attend encore une pensée islamique qui démontre philosophiquement les croyances islamiques. En historien, à plus forte raison : on attend la démonstration que l’Islam est le fruit, mettons, du néoplatonisme syrien. Il y a en fait, il y a une ambiguïté fondamentale chez Luc Ferry, et dans tous les discours des averroïstes modernes, ambiguïté qu’il importe de lever en deux mots : l’Islam est une religion. Et en tant que telle, il sera difficile de la réduire à la raison. On peut l’affirmer, il sera bien plus difficile de le prouver. Averroès en tout cas, ne l’a jamais démontré, et au contraire, son œuvre démontre une influence extérieure, outre la philosophie. Ce sont des faits, et les faits ont un sens. Sauf pour ceux qui les neutralisent, parce qu’avant même de les connaître, ils se sont fait une idée. Or ces faits nous signifient que le rationalisme d’Averroès est une notion subtile, que l’Islam est peut-être différent de ce qu’Averroès a dit et voulu qu’il soit.
4) Le grand problème au fond, du discours de Ferry, c’est qu’il réduit tout à l’identique, au lieu de prêter attention aux différences. Ainsi le logos grec, les Lumières, le rationalisme philosophique, l’Islam, tout revient au même. Il importait au contraire, de bien rappeler qu’il n’en est pas ainsi, et que les différences sont autant de signes. Plus, ces rationalistes modernes depuis Renan, jusqu’à Ferry créent un Averroès ou un Islam à leur image. Ils s’inscrivent alors dans la longue histoire des batisseurs de légende, que seule l’histoire, celle qu’on connaît, peut nous permettre d’esquiver.
Christianisme et modernité
« Tout est chrétien, même l’erreur. Ce n’est pas un paradoxe. Le génie du christianisme est si universel, si pénétrant, si radical qu’il imprègne toutes choses. Depuis la naissance du Christ, il n’est rien dans l’homme qui ne soit affecté d’un coefficient religieux. Toute vérité a désormais un aspect religieux. Toute déviation de la vérité, tout sophisme, toute aberration ont une tonalité religieuse. Il n’y a plus d’autre possibilité pour l’erreur de se manifester que sous forme d’hérésie.
C’est là un mystère, un très grand mystère. Mais sans lui l’histoire de l’humanité après le Christ est rigoureusement inintelligible. Sans lui, elle n’est plus, selon le mot terrible de Shakespeare, qu’une histoire de fou, pleine de bruit et de fureur, racontée par un idiot. Si l’histoire a un sens, même dans ses désordres et dans ses chutes, ce sens ne peut être que chrétien. Chaque fois que nous tentons d’aller au fond des choses en matière historique, nous touchons du doigt la présence irréductible et ubiquitaire du christianisme sous sa forme orthodoxe ou sous sa forme hérétique. L’histoire universelle n’a qu’un seul axe le Christ.
Sur le plan social en particulier, tout désordre, tout détraquement s’est toujours traduit depuis le Christ sous forme d’hérésie. Au moyen àge, il n’est point d’attaque contre l’ordre social qui ne soit en même temps une hérésie chrétienne. Le cas des Albigeois est typique à cet égard. Celui du protestantisme à l’aube des temps modernes ne l’est pas moins. Quant à la Révolution française, nul n’a mieux aperçu que Michelet son caractère hérétique. Il l’a exprimé dans une phrase lapidaire « La Révolution continue le christianisme, elle le contredit. Elle en est à la fois l’héritière et l’adversaire »
C’est la définition même de l’hérésie qui sort du sein du christianisme pour le combattre. Comme l’écrivait, voici longtemps, Maritain, « les idées révolutionnaires sont des corruptions d’idées chrétiennes » et « un ferment divin corrompu ne peut être qu’un agent de subversion d’une puissance incalculable. »
Marcel De Corte – In : La libre Belgique, du 13/XII/1952.
***
« Mes opinions et les vôtres sont à peu près de tout point identiques. Ni vous ni moi n’avons aucune espérance. Dieu a fait la chair pour la pourriture, et le couteau pour la chair pourrie. Nous touchons de la main à la plus grande catastrophe de l’histoire. Pour le moment, ce que je vois de plus clair, c’est la barbarie de l’Europe et sa dépopulation avant peu. La terre par où a passé la civilisation philosophique, sera maudite; elle sera la terre de la corruption et du sang. Ensuite viendra… ce qui doit venir.
Jamais je n’ai eu ni foi ni confiance dans l’action politique des bons catholiques. Tous leurs efforts pour réformer la société par le moyen des institutions publiques, c’est-à-dire par le moyen des assemblées et des gouvernements, seront perpétuellement inutiles.
Les sociétés ne sont pas ce qu’elles sont à cause des gouvernements et des assemblées : les assemblées et les gouvernements sont ce qu’ils sont à cause des sociétés. Il serait nécessaire par conséquent de suivre un système contraire : il serait nécessaire de changer la société, et ensuite de se servir de celle même société pour produire un changement analogue dans ses institutions.
Il est tard pour cela comme pour tout. Désormais la seule chose qui reste, c’est de sauver les âmes en les nourrissant, pour le jour de la tribulation, du pain des forts. »
Juan Donoso-Cortes – In : Où allons-nous ?, de Mgr Gaume, 1844.
***
C’est parce que l’esprit de la modernité est l’héritier hérétique du Christianisme qu’on ne s’en débarassera pas par autre chose que le Christianisme orthodoxe. Le Christianisme est ici l’antidote, et c’est le seul. C’est là aussi une des raisons pour lesquels c’est la société qui doit changer avant les institutions. Car le Christianisme n’est pas une enième religion sociale, mais elle s’adresse aux personnes qui composent la société. Qu’il y ait des chrétiens, et il y aura une société chrétienne. C’est alors que le Christianisme reprendra ses droits, que ces cortèges monstres de religiosité dégénérée que sont nos idéologies modernes disparaitront. Car le chrétien ne saurait adorer l’oeuvre de ses mains.
Matérialisme historique
On pourrait penser, à juste titre, que les églises romanes ont des proportions plus harmonieuses, et que l’atmosphère qui en émane est plus recueillie, il n’empêche que le texte ci-dessous n’est pas sans avoir une certaine âme :
« De même que l’esprit chrétien se retire dans l’intérieur de la conscience, de même l’église est l’enceinte fermée de toutes parts où les fidèles se réunissent et viennent se recueillir intérieurement. C’est le lieu du recueillement de l’âme en elle-même, qui s’enferme aussi matériellement dans l’espace. Mais si, dans la méditation intérieure, l’âme chrétienne se retire en elle-même, elle s’élève, elle s’élève, en même temps, au dessus du fini; et ceci détermine également le caractère de la maison de Dieu. L’architecture prend, dès lors, pour sa signification, indépendante de la conformité au but, l’élévation vers l’infini, caractère qu’elle tend à exprimer par les proportions de ses formes architectoniques. L’impression que l’art doit par conséquent chercher à produire est en opposition à l’aspect ouvert et serein du temple grec; d’abord celle du calme de l’âme qui, détachée de la nature extérieure et du monde, se recueille en elle-même, ensuite, celle d’une majesté sublime qui s’élève, qui s’élance au delà des limites des sens. Si donc les édifices de l’architecture classique en général, s’étendent horizontalement, le caractère opposé des églises chrétiennes consiste à s’élever du sol et à s’élancer dans les airs.
Cet oubli du monde extérieur, des agitations et des intérêtes de la vie, il doit être produit aussi par cet édifice fermé de toutes part. Adieu donc les portiques ouverts, les galeries qui mettent en communication avec le monde et la vie extérieure. Une place leur est réservée, mais avec une toute autre signification, dans l’intérieur même de l’édifice. De même la lumière du soleil est interceptée, ou ses rayons ne pénètrent qu’obscurcis par les peintures des vitraux nécessaires pour compléter le parfait isolement du dehors. Ce dont l’homme a besoin, ce n’est pas de ce qui lui est donné par la nature extérieure, mais d’un monde fait par lui et pour lui seul, approprié à sa méditation intérieure, à l’entretien de l’âme avec Dieu et avec elle-même.
Mais le caractère le plus général et le plus frappant que présente la maison de Dieu dans son ensemble et ses parties, c’est le libre esssor, l’élancement en pointes, formées, soit par des arcs brisés, soit par des lignes droites. Ce libre élancement qui domine tout et le rapprochement au sommet constituent ici le caractère essentiel d’où naissent, d’un côté, le triangle aigu, avec une base plus ou moins large ou étroite, d’autre part, l’ogive, qui fournissent les traits les plus frappants de l’architecture gothique…
L’ogive, dont les arcs semblent d’abord s’élever des pilliers en ligne droite, puis se courbent lentement et insensiblement, pour se réunir en se rapprochant du poids de la voûte placée au dessus, offre l’aspect d’une continuation véritable des pilliers eux-mêmes se recourbant en arcades. Les piliers et la voûte paraissent, par opposition avec les colonnes, former une seule et même chose, quoique les arcades s’appuient aussi sur les chapiteaux d’où elles s’élèvent.
La tendance à s’élever devant se manifester comme caractère principal, la hauteur des pilliers dépasse la largeur de leur base dans une mesure que l’oeil ne peut plus calculer. Les pilliers amincis deviennent sveltes, minces, élancés, et montent, à une hauteur telle que l’oeil ne peut saisir la dimension totale. Il erre ça et là, et s’élance lui-même en haut, jusqu’à ce qu’il atteigne la courbure doucement oblique des arcs qui finissent par se rejoindre, et là se repose; de même que l’âme, dans sa méditation, d’abord inquiète et troublée, s’élève graduellement de la terre vers le ciel, et ne trouve son repos que dans Dieu. »
G.W.F. Hegel, Esthétique, 3ème partie.
Mauvaise foi
Lu ici.
Simone Weil, si proche parfois d’une pensée anarchiste colorée par les irisations de la foi, n’a pas manqué de donner à l’interrogation de La Boétie un vibrant écho dans Oppression et Liberté. Et, comme trop souvent quand elle se tourne vers l’histoire sans majuscule, elle nous a laissé une critique de Marx où défilent nombre des lieux communs que les milieux antitotalitaires ne manqueront pas d’utiliser le moment venu, mais elle y met la prudence et l’intelligence sensible qui lui permettent de voir au delà même de ses propres limites.
Après avoir admis que le matérialisme de Marx ne concerne que la « notion de matière non physique », la « matière sociale » et « non pas la matière elle même », elle ne craint pas de déclarer que « Marx a purement et simplement attribué à la matière sociale ce mouvement vers le bien à travers les contradictions, que Platon a décrit comme étant celui de la créature pensante tirée en haut par « opération surnaturelle de la grâce » ; qu’il aurait oublié « que la production n’est pas le bien » ; et que, à l’instar de ses contemporains, il aurait complètement sous estimé l’importance de la guerre, car, dit elle, « le XIX ème siècle a été obsédé par la production, et surtout par le progrès de la production, et […] Marx a été servilement soumis à l’influence de son époque ».
Autant de contrevérités destinées à ramener Marx dans la problématique mystico chrétienne chère à Simone Weil, de manière à le mesurer à cette aune réductrice. La conception matérialiste de l’histoire laisse en effet le problème épistémologique de la « matière » aux abstracteurs de quintessence, aux philosophes, et elle s’en tient à l’analyse des rapports de production et de classes d’une société donnée ; aux conditions « matérielles » qui définissent ce que Marx pensait être la dernière forme d’exploitation non parce que la « matière sociale » en aurait ainsi décidé, mais parce que la production permettrait enfin de satisfaire les besoins du plus grand nombre et que la lutte des classes « tirerait » l’histoire vers le « bien », à savoir la solution d’un conflit qui n’aurait désormais plus de raison de s’en remettre à la « grâce », ou à « l’esprit » pour trouver une issue.
Chacun aura compris que cette matière sociale englobe aussi bien la culture que la politique et l’économie. Quant à l’histoire qui succéderait à la préhistoire, Marx ne pouvait ignorer qu’elle ne serait à l’abri ni des souffrances ni des conflits ; mais il pensait, en s’en tenant à une mesure du « progrès » fondée sur des besoins élémentaires dont la satisfaction a de tout temps été suspendue à l’activité « économique » , que ces inévitables maux seraient différents de ceux qui endeuillent les sociétés d’exploitation. Partant, il n’érigeait nullement « la production » en deus ex machina de l’histoire, mais il s’efforçait d’en expliquer rationnellement les effets et son rapport à la structure hiérarchique de la société.
La première phrase du deuxième paragraphe marque la pointe du raisonnement : Simone Weil a tort, elle a mesuré Marx à l’aune réductrice de la problématique mystico-chrétienne. Il n’y a pas de puisque ou de parce que entre ces bouts de phrases, mais croit deviner que l’auteur aurait bien voulu placer là une de ces deux conjonctions. Il peut être bon dès lors de se rafraîchir la mémoire. A l’automne 1934, Simone Weil achève la rédaction de ses Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, commencées d’écrire en mai de la même année, après avoir achevé, l’année précédente, Allons nous vers une révolution prolétarienne ?, où se trouve l’essentiel de sa critique du marxisme. Sa première expérience mystique date de l’automne 1938. Entre temps, elle avait déjà commencé d’écrire Oppression et Liberté. Il donc évident que ce n’est pas le christianisme qui a inspiré à Simone Weil sa critique du marxisme. (Pour situer cette critique de S. Weil dans son contexte, il peut être bon également de rappeler qu’elle fut amenée par la suite à rejoindre quelque peu Proudhon et à écrire l’Enracinement). En fait de réduction, c’est bien Louis Janover qui tient le haut du pavé, en ne considérant qu’ Oppression et Liberté et en oubliant les Réflexions et les articles précédents, non seulement il en vient à falsifier l’histoire, mais en plus il passe à côté du sens véritable de la critique de Simone Weil.
Le nerf de la critique de Simone Weil, c’est le chapitre II des Réflexions qui nous le livre :
Avant même d’examiner la conception marxiste des forces productives, on est frappé par le caractère mythologique qu’elle présente dans toute la littérature socialiste, où elle est admise comme un postulat. Marx n’explique jamais pourquoi les forces productives tendraient à s’accroître; en admettant sans preuve cette tendance mystérieuse, il s’apparente non pas à Darwin comme il aimait à le croire, mais à Lamarck, qui fondait pareillement tout son système sur une tendance inexpliquable des êtres vivants à l’adaptation. De même pourquoi est-ce que, lorsque les institutions sociales s’opposent au développement des forces productives, la victoire devrait appartenir d’avance à celles-ci plutôt qu’à celles-là ? Marx ne suppose évidemment pas que les hommes transforment consciemment leur état social pour améliorer leur situation économique; il sait fort bien que jusqu’à nos jours les transformations sociales n’ont jamais été accompagnées d’une conscience claire de leur portée réelle ; il admet donc implicitement que les forces productives possèdent une vertu secrète qui leur permet de surmonter les obstacles. Enfin, pourquoi pose t’il sans démonstration, et comme une vérité évidente, que les forces productives sont susceptibles d’un développement illimité ? Toute cette doctrine, sur laquelle repose entièrement la conception marxiste de la révolution, est absolument dépourvue de caractère scientifique. Pour la comprendre, il faut se souvenir des origines hégéliennes de la pensée marxiste. Hegel croyait en un esprit caché à l’oeuvre dans l’univers, et que l’histoire du monde est simplement l’histoire de l’esprit du monde, lequel, comme tout ce qui est spirituel, tend indéfiniment à la perfection. Marx a prétendu « remettre sur ses pieds » la dialectique hégélienne, qu’il accusait d’être « sens dessus dessous »; il a substitué la matière à l’esprit comme moteur de l’histoire; mais par un paradoxe extraordinaire, il a conçu l’histoire, à partir de cette rectification, comme s’il attribuait à la matière ce qui est l’essence même de l’esprit, une perpétuelle aspiration au mieux. Par là, il s’accordait d’ailleurs profondément avec le courant général de la pensée capitaliste; transférer le principe du progrès de l’esprit aux choses, c’est donner une expression philosophique à ce « renversement du rapport entre le sujet et l’objet » dans lequel Marx voyait l’essence même du capitalisme. L’essor de la grande industrie a fait des forces productives la divinité d’une sorte de religion dont Marx a subi malgré lui l’influence en élaborant sa conception de l’histoire. Le terme de religion peut surprendre quand il s’agit de Marx; mais croire que notre volonté converge avec une volonté mystérieuse qui serait à l’oeuvre dans le monde et qui nous aiderait à vaincre, c’est penser religieusement, c’est croire à la Providence. D’ailleurs, le vocabulaire même de Marx en témoigne, puisqu’il contient des expressions quasi mystiques, telles que « la mission historique du prolétariat ». Cette religion des forces productives au nom de laquelle des générations de chefs d’entreprise ont écrasé les masses travailleuses sans le moindre remords, constitue également un facteur d’oppression à l’intérieur du mouvement socialiste; toutes les religions font de l’homme un simple instrument de la Providence, et le socialisme lui aussi met les hommes aus ervice du progrès historique, c’est à dire le progrès de la production. C’est pourquoi quel que soit l’outrage infligé à la mémoire de Marx par le culte que lui vouent les oppresseurs de la Russie moderne, il n’est pas entièrement immérité. Marx, il est vrai, n’a jamais eu d’autre mobile qu’une aspiration généreuse à la liberté et à l’égalité; seulement, cette aspiration, séparée de la religion matérialiste avec laquelle elle se confondait dans son esprit, n’appartient plus qu’à ce que Marx appelait dédaigneusement le socialisme utopique.
Même si on ne connaissait pas la date de publication de l’ouvrage dont est tiré cet extrait, on serait forcé d’admettre qu’il n’y a pas de trace d’influence du christianisme là-dedans. La critique de Simone Weil consiste simplement à constater que tout un pan du marxisme n’est pas scientifique pour un sou, et rien de plus. Elle reproche au marxisme d’avoir appliqué « inconsciemment aux organismes sociaux le fameux principe de Lamarck, aussi inintelligible que commode, « la fonction crée l’organe ». « La biologie, ajoute t’elle, n’a commencé d’être une science que le jour où Darwin a substitué à ce principe la notion des conditions d’existence ». La conclusion tombe d’elle-même quelques lignes plus loin : « Pour pouvoir se réclamer de la science en matière sociale, il faudrait avoir accompli par rapport au marxisme un progrès analogue a celui que Darwin a accompli par rapport à Lamarck ». Ce n’est que plus tard que notre auteur dira en substance, que Marx a été un faux prophète et que sa religion était idolâtre. En attendant, pour qui ne croit pas que « l’idée de progrès est l’idée athée par excellence« , la critique de Simone Weil n’est pas pour autant sans valeur.
Ce n’est pas tout. Non seulement ces oeuvres ne répondent à aucune problématique mystico-chrétienne, mais elles sont exemptes de contrevérités, contrairement à ce qu’annonce Janover. En fait, la réfutation sommaire qu’il entreprend dans le troisième paragraphe cité ci-dessus, n’a rien de concluant. D’abord, Janover a beau rétorquer que « la conception matérialiste de l’histoire laisse le problème épistémologique de la matière aux abstracteurs de quintessence, aux philosophes »; il n’en reste pas moins vrai de dire que l’historicisme de Marx, implicitement basé sur l’idée lamarckienne de progrès, revient à considérer que la matière sociale se meut d’elle même vers le bien. Car ces mots de Simone Weil ne sont pas vraiment un travail d’abstracteur de quintessence ou d’épistémologue, mais plutôt une autre façon d’exprimer la même idée de « progrès interne » qu’elle voit en filigranne dans l’oeuvre de Marx. Ensuite, il n’est pas vrai de dire que « la conception matérialiste de l’histoire s’en tient à l’analyse des rapports de production et de classes d’une société donnée », si l’on entend par société donnée une société passée ou présente, puisque Marx théorise également une société qu’il considère comme à venir, la société communiste, celle qui en vertu de ses principes, « pourra écrire sur ses drapeaux : de chacun selon ses moyens,à chacun selon ses besoins ». Ensuite, lorsqu’il dit que « la conception matérialiste de l’histoire s’en tient aux conditions « matérielles » qui définissent ce que Marx pensait être la dernière forme d’exploitation non parce que la « matière sociale » en aurait ainsi décidé, mais parce que la production permettrait enfin de satisfaire les besoins du plus grand nombre et que la lutte des classes « tirerait » l’histoire vers le « bien », à savoir la solution d’un conflit qui n’aurait désormais plus de raison de s’en remettre à la « grâce », ou à « l’esprit » pour trouver une issue », Janover n’ôte pas à la critique de Simone Weil son objet. En effet, cette critique porte précisément sur la raison ou plutôt l’absence de raison qui permet aux marxistes de penser que les conflits puissent trouver une issue dans une hypothétique société communiste. Selon elle, il n’y a aucune raison de penser, lorsqu’on est acquis au matérialisme historique, que l’oppression tant honnie disparaisse. Ce sont précisément des axiomes du genre de celui-ci « parce que la production permettrait enfin de satisfaire les besoins du plus grand nombre », qui tombent sous la critique de Simone Weil, car il ne convient pas, venant de qui veut mériter le titre de scientifique, de se contenter de poser comme évidente telle ou telle progression, mais bien de mettre en évidence quelles sont les causes qui rendent ces progressions inéluctables. Or ce sont bien de telles preuves qui manquent à la doctrine marxiste, bien que celle-ci ne manque pas de se proclamer scientifique.
Résumons : De deux choses l’une ; ou bien Janover se montre incapable de comprendre la critique, pourtant simple, de S.Weil, ou bien il fait mine de ne pas la comprendre. Et quoiqu’il en soit, il ne nous livre rien qui nous oblige à prendre S.Weil pour une demeurée aux tendances mystico chrétiennes. Que les camarades se passent le mot.
Droit de critique
1- Le procédé qui consiste à brosser un tableau général de l’histoire économique, à constater que globalement, la courbe de la productivité a crû de façon remarquable depuis la révolution industrielle, pour en venir à poser comme évident un lien de cause à effet entre le libéralisme et cette hausse de productivité est pour le moins simpliste, ce pour deux raisons. D’abord, parce qu’une hausse générale n’est pas une hausse absolue, et qu’il y a fort à parier que derrière ce tableau général, se cachent des particularités, des sommes de progressions et de régressions, qui nuancent un peu la couleur générale. Ensuite, parce que le lien de causalité que l’on veut nous faire observer n’est pas exclusif. Une fois qu’on a pris conscience de la complexité de la question, il reste à en soumettre l’examen aux historiens, qui se chargeront de déterminer les tenants et les aboutissants du problème. En l’absence de connaissances véritables et précises -et nous avouons le plus humblement possible que nous sommes dans ce cas- il est impossible de discuter de la question sans faire oeuvre de propagande (le mot n’est pas trop fort, car il s’agirait bien ici de mettre l’histoire au service d’une opinion préétablie en présentant une image déformée de la réalité *).
Mais puisque par ailleurs, nous nous attribuons quelque compétence dans le domaine philosophique, qu’il nous soit permis cependant de clarifier quelques concepts. Si l’on définit le capitalisme comme une technique de production, et le libéralisme comme une doctrine économique capitaliste, il paraît hasardeux de déclarer celle-ci cause de la hausse de productivité plutôt que celle-là. Pour un libéral, la question est tranchée d’avance, puisque le bon rendement capitaliste, selon lui, est assuré par la libre concurrence. Plus celle-ci sera effectivement libre, et plus elle permettra de produire de richesses, et les bons rendements du capitalisme seront automatiquement attribués au libéralisme. Mais pour qui n’est pas encore acquis à la doctrine de la Concurrence Pure et Parfaite, la question reste entière, et l’histoire n’a pas dit ce qu’on voulait qu’elle affirmât. Et on a pu démontrer que celui qui se faisait passer pour un historien était en fait un économiste, ce qui n’a pas effet au meilleur chef de nous convaincre de la pertinence de son propos.
Par ailleurs, aurait-on tort de dire que le socialisme, comme le communisme d’ailleurs, n’a jamais été mis en oeuvre ? Il n’a pas manqué et il ne manque pas de sociétés qui se disent libérales. Mais y en a t’il eu une seule qui fonctionne ou a fonctionné véritablement selon le seul mécanisme de la libre concurrence ? Voilà une question d’histoire, et comme nous ne nous sentons aucunement capable d’endosser la responsabilité d’y répondre, laissons-la entière. En revanche, il semble difficile de nier que partout où le capitalisme a été introduit, il a su régler les problèmes de sous-production, et donc favoriser le bien-être. La société française en est un exemple parmi tant d’autres. C’est pourquoi nous voudrions avec toutes les réserves que notre incompétence en la matière exige, proposer la sentence suivante : à proprement parler, le libéralisme n’a pas produit plus de richesses que le communisme. En Occident comme en URSS, c’est le capitalisme qui a produit de la richesse ; en Occident, le capitalisme libéral, en URSS, le capitalisme d’état.
(à suivre)
_____________________
* L’appropriation de l’histoire permet au plus haut titre, de faire passer dans les masses au rang de dogmes les théories les plus discutables. Une fois brossé un tableau de l’histoire conforme à ce que la réalité devrait être pour qu’elle puisse appuyer une démonstration de la théorie que l’on entend prouver, ce tableau est d’autant plus efficace qu’il ne se prétend pas une démonstration, mais une évidence. L’histoire en effet, n’est pas à proprement parler, un argument. Elle est une description de la réalité, un modèle, et de tous les modèles possibles, elle est sans doute celui qui semble le plus conforme à son objet. L’histoire authentique est une science fort noble, qui n’a pas grand chose à voir avec le procédé dont nous parlons, et il n’est pas question ici de la mépriser, mais de constater combien, et combien plus que les sciences spéculatives, parce qu’elle fait voir des faits, et non des concepts abstraits, elle peut faire tourner la tête de ceux qui n’ont pas autant qu’il faudrait, le sens de la distance qu’il y a entre une science et son objet. Il n’est pas sans intérêt de constater que le scepticisme moderne a finalement débouché sur l’historicisme qui fait rage aujourd’hui, comme le scientisme emportait les plus grands esprits au XIXème siècle. Autrefois, le sceptique déclarait le réel inassimilable. Aujourd’hui, l’historiciste se l’approprie.
Héloïse et Abélard -2-
Sagesse
« Malgré les problèmes qu’elle laisse encore à résoudre, l’histoire d’Héloïse et d’Abélard est assez riche d’enseignement pour qu’il vaille la peine de les recueillir. » C’est l’objectif avoué de Gilson dans le dernier chapitre de son livre, Héloïse et Abélard. Le titre du chapitre –La leçon des faits– est à lui seul tout un programme : à partir des faits historiques et de l’histoire d’Héloïse et d’Abélard en particulier, donner une leçon d’histoire aux théoriciens comme Jacob Burckhardt au premier chef, pour son Histoire de l’Italie au temps de la Renaissance, ou Gustave Cohen et Abel Lefranc, respectivement cités à travers Ronsard, sa vie et son oeuvre, et la Revue des Cours et Conférences.
« Pour Jacob Burckhardt, écrit Gilson, […] la Renaissance est caractérisée par la découverte du monde et par la découverte de l’homme : « elle est la première à découvrir et à montrer au grand jour l’homme dans son entier ». Une fois le principe posé, les conséquences suivent d’elles-mêmes : « cette époque développe l’individualisme au plus haut point ; ensuite elle l’amène à étudier avec passion, à connaître à fond ce qui est individuel à tous les degrés. […] Pour Burckhardt, l’essentiel n’est d’ailleurs pas là ; ce qu’il tient à prouver avant tout, c’est que des individualités si puissantes ne pouvaient apparaître pour la première fois que dans les petites tyrannies italiennes du XIVème siècle, où les hommes mènent une vie personnelle si intense qu’ils éprouvent le besoin de se raconter. C’est pourquoi, « chez les Italiens, l’autobiographie elle-même (et non plus simplement l’histoire) étend parfois son vol et descend dans les profondeurs de l’individu ; à côté des mille faits de la vie extérieure, elle décrit d’une manière saisissante les phénomènes moraux, tandis que chez d’autres nations, y compris chez les Allemands du temps de la Réforme, elle se borne à consigner les faits matériels et ne laisse deviner l’âme du personnage que par la manière de les présenter. On dirait que la Vita Nuova de Dante, avec son implacable vérité, ait ouvert à la nation cette voie nouvelle ». A cette vision de l’homme de la Renaissance, s’oppose celle de l’homme du Moyen Age, écrasé et nivellé par le Christianisme : « L’Eglise devenue maîtresse, ne tolère pas le développement individuel de l’homme. Tous doivent se résigner à devenir de simples anneaux dans la longue chaîne de son système et obéir aux lois de ses institutions. »
Où situer la correspondance d’Héloïse et d’Abélard ? « Nul n’aura la sottise de comparer leur correspondance à la Vita Nuova sur le plan littéraire, répond Gilson, mais s’il s’agit de dire dans laquelle des deux oeuvres la description de l’homme moral s’affirme avec la simplicité la plus directe et la plus dépouillée d’artifice, c’est au tour de la Vita Nuova de ne plus supporter la comparaison. » Mais Héloïse et Abélard sont deux êtres du Moyen Age, et deux français sujets d’une monarchie, « ils ne satisfont à aucune des conditions requises par la théorie, sauf d’avoir été juste ce qu’ils n’auraient pas dû être si la théorie était vraie ». Ainsi, les faits contredisant la théorie, une fois établi que « l’interprétation du Moyen Age et de la Renaissance que nous avons sous les yeux n’est aucunement, comme on pourrait le croire, une hypothèse historique justiciable des faits », il ne reste plus qu’à conclure qu’elle est un mythe. C’est le mot qu’emploie Gilson, parce qu’un mythe « dicte les faits ». A l’inverse de ce refus de considérer les faits, afin de bâtir une hypothèse historique sur leur enseignement, Gilson oppose une méthode que l’on pourrait qualifier de réaliste : « Pour sortir de cette confusion, il conviendrait peut-être de commencer par se souvenir que les expressions : Moyen Age, Renaissance, sont les symboles abstraits de périodes chronologiques d’ailleurs mal définies et qu’il n’y a pas lieu d’espérer qu’on leur fasse un jour correspondre des définitions simples, applicables à tous les faits qu’elles désignent. Il n’y a pas eu d’essencedu Moyen Age et de la Renaissance, c’est pourquoi il ne saurait y en avoir de définition. » Les faits y servent de preuves : « Tandis que saint Thomas proclame la théologie regina, et même dea scientiarum, les Averroïstes enseignent que « seuls les sages qu’il y ait au monde sont les philosophes seulement, qu’on en sait pas davantage pour savoir la philosophie » et que les enseignements théologiques sont fondés sur des fables ». De tout cela qu’est-ce qui est médiéval ? Tout est médiéval. »
Evidemment, la correspondance des deux amants n’est pas seul chose à infirmer la thèse de Burckhardt, mais aussi et surtout les personnalités des auteurs de cette correspondance. « Si Abélard est un écueil fatal à la thèse de Burckhardt, Héloïse, à elle seule, en est un plus dangereux encore, non pas à cause de l’ardeur passionée avec laquelle elle s’analyse, ni de l’air de défie avec lequel cette femme publie ses secrets les plus intimes, mais bien par les idées mêmes qu’elle exprime et le contenu même de ce qu’elle dit. » Ce dernier point est donc longuement développé par Gilson. Il montre ainsi que la doctrine d’Héloïse concernant les règles monastiques rejoint dans ses déductions et ses conclusions celle d’Erasme. « Le Christ n’a prêché qu’une seule religion, la même pour les laïques et pour les moines ; l’homme chrétien renonce au monde et fait profession de ne vivre que pour le Christ, et saint Paul n’a pas prêché cette doctrine (Rom, XIII, 14) pour les moines mais pour tous ; les laïcs, même mariés, sont tenus à la charité et à la pauvreté tout autant que les moines ; bref, la seule règle à laquelle un chrétien soit tenu, c’est l’Evangile ». C’est aussi l’enseignement de Luther qui écrit plus tard dans Sur les voeux monastiques : « Faire un voeu monastique, c’est dire : « Seigneur je jure de n’être plus chrétien. Je rétracte le voeu de mon baptême. Je ne veux plus m’attacher au Christ ni vivre en Lui… Je jure d’observer au dessus et en dehors du Christ, un voeu nouveau et bien meilleur à savoir par mes propres oeuvres de chasteté, d’obéissance et de chasteté ». Les voeux monastiques chez Héloïse comme chez les humanistes et les réformateurs sont vus comme une pratique judaïsante, car ils supposent que les actes du chrétien ont une valeur. Or, s’appuyant sur saint Augustin (De bono conjugali, De Sermone Domini in monte), Abélard -et Héloïse à sa suite- affirme que « la qualité bonne ou mauvaise de l’acte réside entièrement dans l’intention qui l’anime. » Autrement dit, les bonnes oeuvres sont inutiles, et seul l’esprit sert au salut. L’envie ne nous manque pas de réfuter ces doctrines, bien que ce ne soit pas le lieu ici. Disons en deux mots que de telles vues de l’esprit ne sont possibles que lorsqu’on oppose la chair à l’esprit, et non l’homme de chair à l’homme d’esprit. Il y a plus : par l’usage qu’elle fait de cette doctrine, « Héloïse inaugure la longue lignée de tant d’héroïnes romantiques, que la fatalité condamne à faire le mal par amour, mais que la pureté même de leur amour disculpe du mal qu’elles font ; ou qu’elle entraîne à commettre des crimes, mais des crimes dont elles restent innocentes dans le temps même qu’elles les commettent, et tout cela au nom d’une morale qui sépare l’ordre des actes de l’ordre des intentions. » Etienne Gilson, comparant Héloïse à la Julie d’Etanges de Rousseau note qu’en « substituant déjà la psychologie à la morale, l’ancienne Héloïse dépasse de loin la nouvelle dans la voie même où elle l’invitait à s’engager. »
Voilà donc les faits à charge contre la théorie de Burckhardt. Et voici la leçon, d’ordre philosophique : le but de l’histoire est la connaissance. En effet, « Devant une réalité perçue devant sa complexité ordonnée, qui donc se souciera encore de formules ? Ce n’est pas pour nous débarasser d’elle que nous étudions l’histoire, mais pour sauver du néant le passé qui s’y noierait sans elle ; c’est pour faire ce qui, sans elle, ne serait même plus du passé, renaissance à l’existence dans cet unique présent hors duquel rien n’existe. »
Héloïse et Abélard -1-
Héloïse et Abélard, d’Etienne Gilson.
Amour
« Eprouve moi, Seigneur, sonde moi, fais passer au creuset mes reins et mon coeur. »
Psaume XXV, 2
La nature d’Abélard telle que nous la révèle sa correspondance traduite par Etienne Gilson est un exemple de la description poétique de Vladimir Volkoff qui se représente l’homme « les pieds dans la glaise et la tête touchant la voûte céleste« . La vie d’Abélard est bien celle d’un homme aux instincts bas et aux aspirations hautes. C’est la luxure et l’orgueil qui poussent Abélard à ignorer l’idéal de continence qu’il tient de Sénèque et de saint Jérôme. « Vue du côté d’Abélard, la séduction d’Héloïse telle que lui-même la raconte fut une affaire assez basse […]. Pas la moindre trace de passion romantique dans son cas ; rien que de la luxure, comme il en convient lui-même, et de l’orgueil. Fortuna blandiens commodiorem nacta et occasionem : Héloïse est surtout pour lui une occasion trop commode pour la laisse échapper. Elle n’est pas laide de visage – facie non infima – voilà pour la luxure ; au moment où Abélard la rencontre, elle l’emporte déjà de bien loin par sa science sur toutes les femmes de son temps : voilà pour l’orgueil. » Ainsi que ce clerc, professeur de Théologie, manigance pour se rapprocher de sa proie. Il devient le professeur de la jeune fille et n’a pas de peine à la séduire.
Lorsque Héloïse tomba enceinte, Abélard l’enleva pour la cacher en Bretagne, où elle accoucha d’un fils, Asrolabe. Abélard résolu alors d’épouser son amante, et en demanda la main à Fulbert, l’oncle de la jeune fille, en précisant que le mariage serait tenu secret, afin que sa gloire n’en pâtisse pas, car un clerc, qui plus est, professeur de Théologie, se doit de se montrer digne de la vie cléricale, qui exige de respecter l’idéal de continence. C’est saint Jérôme de qui Abélard tire cet idéal. Il aurait pu également citer saint Paul : « Il est bon que l’homme s’abstienne de la femme ». Car qu’il s’agisse de Saint Jérôme ou saint Paul, qu’ils tirent leur doctrine respectivement de Sénèque ou de la Genèse, tous deux en arrivent à la même conclusion, qui fait de la continence l’état de vie le plus conforme à la nature de l’homme. L’Ecriture ne dit-elle pas sans ambage que « l’homme a été créé pour Dieu, et la femme pour l’homme »? Abélard aurait bien pu signer avec des siècles d’avance, cette phrase de Gustave Thibon qui fait de l’amour, « la servitude de l’homme et la grandeur de la femme ». D’autre part, par le mariage, l’homme ne s’appartient plus, il cède de son autonomie à sa femme. Abélard pense que la famille d’Héloïse s’estimera vengée de l’affront qui lui a été fait par ce seul mariage secret. Or l’affront est public, pas privé. La réparation devrait se faire au grand jour, pas dans le secret. Héloïse lui dépeint l’existence contradictoire qui sera la sienne après ce mariage, le bon sens lui crie que les témoins du mariage finiront certainement par parler, que Fulbert a intérêt à ce que ce mariage ne reste pas secret, mais rien n’y fait, Abélard n’entend plus renoncer à posséder Héloïse. Il ne peut plus se passer d’elle, au point de sacrifier à cette possesion son idéal et son autonomie, mais pas son orgueil.
D’après Gilson, c’est sur un malentendu que Fulbert fait châtrer Abélard, car ce dernier ne voulait certainement pas se débarrasser d’Héloïse en l’envoyant au couvent, mais plutôt n’entendait pas renoncer à sa gloire terrestre et souhaitait démentir les rumeurs qui disaient que les amants s’étaient mariés. L’on voit bien que la déchéance d’Abélard vient de la situation impossible dans laquelle il s’est mise.
« Pour ne pas se perdre dans la psychologie d’Héloïse, telle du moins que les documents permettent de la comprendre, il faut savoir que sa passion et celle d’Abélard avaient suivi des évolutions différentes. Au début, on ne trouve chez Abélard qu’un froid calcul au service d’une sensualité déchaînée ; puis on le voit entraîné par une passion violente, pour laquelle il accepte de se dégrader à ses propres yeux et, puisqu’il le faut pour sauver sa réputation, de fonder toute sa vie sur un mensonge. Du côté d’Héloïse au contraire, après une réddition totale qui semble s’être faite sans lutte, paraissent des hésitations et des scrupules dont la réalité ne saurait être mise en doute. » Pendant qu’Abélard cherchait un objet de sensualité, Héloïse en cédant témoigne d’amour humain. N’est ce pas elle qui avouera à son amant devenu entre temps son mari cette passion qui a pris possession d’elle dès le début de leur relation, ce sentiment qui lui a fait placer Abélard au centre de toutes préoccupations ? : « Jamais, Dieu le sait, je n’ai cherché en toi rien d’autre que toi ; te pure , non tua, concupiscens. Ce ne sont pas les liens du mariage ni un profit quelconque que j’attendais, ce ne sont ni mes volontés, ni mes voluptés, mais, et tu sais bien toi même, les tiennes, que j’ai eu à coeur de satisfaire. Certes, le nom d’épouse semble plus sacré et plus fort, mais j’ai toujours mieux aimé celui de maîtresse, ou, si Dieu me pardonne de le dire, celui de concubine et de prostituée. Car plus je m’humiliai pour toi, plus j’espérai trouver grâce auprès de toi et, en m’humiliant ainsi, ne ternir en rien la splendeur de ta gloire. »
Héloïse entra donc sur ordre de son mari au couvent, et sans qu’il y ait en elle la moindre trace de vocation, elle devint la première abbesse du Paraclet, pendant qu’Abélard devenait moine et recevait la prêtrise. On a vu Abélard tomber de son piédestal par la luxure et s’enfoncer dans les tribulations par son orgueil. Mais désormais, c’est un Abélard converti, grandi par l’épreuve qui écrit son histoire : « Par un juste jugement de Dieu, j’étais puni dans la partie de mon corps où j’avais péché. Par une juste trahison, celui que j’avais moi-même trahi m’avait rendu la pareille. » Dans la correspondance qu’il tient avec Héloïse apparaît alors souvent son désir d’entraîner sa femme dans son ascension spirituelle. « A partir de ce point en effet, Abélard ne cessera plus de grandir, car s’il ne fut pas tout à fait aussi grand philosophe qu’on voulait le lui faire croire, ni aussi grand théologien qu’il le croyait lui-même, il allait devenir aussi grand chrétien pour satisfaire à la fois Bernard de Clairvaux et Pierre le Vénérable. Ce n’est pas un médiocre succès. Mais il n’est que juste d’ajouter que, tendu comme lui-même l’était vers la perfection chrétienne, Abélard fit l’impossible pour y conduire Héloïse. » Abélard franchit les degrés de l’amour, il se montre chrétien en ce qu’il parvient à aimer Héloïse dans le Christ : Abélard touche la note juste qu’il ne perdra plus désormais, écrit Gilson : »A Héloïse, sa bien aimée soeur dans le Christ, Abélard son frère en Lui… Soeur qui me fut chère dans le siècle, à présent très chère dans le Christ. » En effet, poursuit l’auteur, « Jésus Christ est à Héloïse, puisqu’elle est devenue son épouse, mais Abélard aussi est à Héloïse, puisqu’ils ne font qu’un par le mariage. Tout ce qui est à Héloïse est à Abélard, et Jésus Christ même : « Nous sommes un dans le Christ, nous sommes une seule chair par la loi du mariage. Or le Christ est tien puisque tu es devenue son épouse… Aussi est-ce en ton appui, près de lui que je mets mon espoir, pour obtenir par ta prière ce que je ne peux obtenir par la mienne ». Quelle union plus totale, plus intime, plus haute et plus digne de la grande âme d’Héloïse Abélard pouvait-il encore lui offrir ? » Au moment où son mari se dévoue corps et âme à son salut éternel, Héloïse reste prisonnière de sa passion humaine. C’est ainsi qu’Etienne Gilson note que « la moindre parcelle d’amour de Dieu, semble t’il, serait pour elle autant de volé à l’amour exclusif qu’elle a voué pour toujours à Abélard, et qu’elle lui a totalement réservé. »
Abélard meurt l’an de grâce 1142, et Héloïse le suit dans la tombe 21 ans plus tard. « Ici finit l’histoire et commence la légende. On rapporte que, peu de temps après sa mort, Héloïse avait pris les dispositions nécessaires pour être ensevelie avec Abélard. Lorsqu’on ouvrit sa tombe et que l’on l’y déposa près de lui, il étendit les bras pour l’accueillir, et les referma étroitement sur elle. Ainsi contée, l’histoire est belle, mais légende pour légende, on croirait plus volontiers qu’en rejoignant son ami dans la tombe, Héloïse ait ouvert les bras pour l’embrasser. »
…/…
Les racines de la pensée chrétienne
La pensée chrétienne est avant toute chose théologique, et c’est ce qui fait qu’elle est chrétienne. Le point de départ de la théologie, c’est la foi. Sans foi, pas de théologie, et pas de philosophie chrétienne, puisque celle-ci est contenue dans la théologie. Or la théologie a besoin de la philosophie pour expliciter les vérités qui sont l’objet de son étude. Un théologien est nécessairement un philosophe.
Ainsi les plus anciennes pages de pensée chrétienne qui nous soient parvenues sont celles du Nouveau Testament, des Evangiles aux Actes des Apotres. Même si leurs auteurs n’exposaient pas la leur doctrine, l’essentiel de leur enseignement étant oral, et les Evangiles ayant été écrit afin de rétablir la vérité sur la vie de Jésus, d’exclure les fables pieuses et moins pieuses qui avaient cours dans la chrétienté naissante, ces pages sont essentiellement théologiques. Saint Paul, les Apotres n’avaient probablement pas lu Platon, et même a supposer qu’ils l’aient lu, on ne peut pas dire que l’on en ait trouvé la moindre trace dans les épitres. Le centre de la théologie de saint Paul est le Christ, c’est a dire, dans ses yeux de chrétien, le Messie, le Rédempteur du genre humain, esperé par les Patriarches et annoncé par les Prophètes. De même, l’essentiel des discours de saint Pierre que nous relatent les Actes des Apotres, tournent autour de cet axe fondamental, qui fait de Jésus Christ l’incarnation des prédictions des Prophètes. C’est affirmer un lien particulier entre la doctrine professée par les patriarches et celle de ces premières pages de théologie chrétienne. Les romains ne s’y trompaient pas, qui instruits de la doctrine juive par des sages y associaient celle des chrétiens. Sénèque par exemple, fait souvent la confusion. La pensée de Hegel qui voulait faire du christianisme une synthèse de la théologie juive et de la philosophie grecque est infirmée par l’histoire, puisque les premiers chretiens qu’étaient les Apotres n’ont jamais tiré leur enseignement d’une quelconque philosophie grecque, mais bien de Jésus Christ seul, qui a parfait la Révélation que Dieu avait fait aux Patriarches. Pour adhérer a cette pensée d’Hegel, le chrétien est contraint de ne voir dans le catholicisme qu’une philosophie plus ou moins en rapport avec l’enseignement du Christ, ce qui est impossible aux yeux de sa foi.
Ce n’est que plus tard, avec la conversion de gentils de culture gréco-romaine que l’on voit la philosophie grecque s’insérer dans le cours des raisonnements des chrétiens. Pour expliciter la doctrine, Origène, Tertullien, et saint Augustin se servent des philosophies paiennes de Platon, et de Plotin. Le travail de relecture chrétienne de Platon par saint Augustin s’avère difficile, la philosophie de Platon s’écartant en des points essentiels de celle que sous tend la foi catholique. Saint Augustin nous a laissé un grand témoignage de philosophie chrétienne a travers le livre des réfutations, ou il expose comment la doctrine de Platon, qu’il avait fait sienne sur plusieurs points importants sans un discernement theologique suffisant, l’avait conduit a errer dans la Vérité.
Il y a une philosophie inhérente a la théologie. Il y a une philosophie, une psychologie paulinienne, qui se lit entre les lignes théologiques, c’est une certaine conception de l’homme et dela vie qui s’imprime avec et par la foi. La théologie dispose donc pour son oeuvre d’explicitation et développement de la doctrine, d’une philosophie qui lui est propre, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne puisse pas utiliser une philosophie qui lui est étrangère. Ainsi, au XIII ème siècle, saint Thomas n’hésita pas a se servir des terminologies et des raisonnements d’Aristote pour expliciter sa théologie. Ici il faut avoir bien a l’esprit les liens qui sont tissés entre la philosophie et la théologie dans la pensée chrétienne. Cette dernière peut etre théologique ou philosophique, mais dans le deuxième cas, elle n’est pas autonome, elle dépend toute entière de la théologie. A ceux qui accusaient saint Thomas, de meler l’eau de la philosophie au vin de l’Ecriture, ce grand théologien répondit : « Ceux qui recourent a des arguments philosophiques en Ecriture sainte, et les mettent au service de la foi, ne melent pas l’eau au vin, ils changent l’eau en vin ». Il faut bien comprendre la que la philosophie de saint Thomas n’est pas celle d’Aristote. Certes la philosophie de saint Thomas est aristotélicienne, mais elle n’est pas que cela.
Par exemple saint Thomas reprend le raisonnement d’Aristote concernant la necessité d’un premier moteur, comme cause première du mouvement. Mais le Dieu d’Aristote n’est pas le Dieu de saint Thomas. Et au dela, le Dieu des philosophes n’est pas celui des chretiens. Le Dieu des chrétien est connu avant tout par la Révélation, pas par le syllogisme philosophique. Le Dieu des chrétiens, c’est cet Etre en qui réside la plénitude des perfections. C’est ce Dieu qui s’est révélé aux premiers hommes, a Abraham, a Isaac et a Jacob, puis a Moise sur le mont Sinai. Celui qui a dit : « Je suis celui qui suis« . Un Dieu personnel, l’Etre en tant qu’etre, que seule la théologie juive a enseigné et connu par la foi et par la raison. La conception de Dieu de saint Thomas d’Aquin découle toute entière de l’Exode. Sa doctrine est explicitée avec l’aide des terminologies et méthodes syllogistiques d’Aristote, mais la substance de cette doctrine est dans l’antique théologie juive.
Certes, il y a dans la pensée grecque quelques points de rencontre avec la doctrine chrétienne, mais cela ne fait pas d’elle une pensée chrétienne. (Si tant est d’ailleurs que l’on puisse parler de philosophie grecque, puisque les Anciens n’ont jamais parlé d’une seule voix). Telles quelles les philosophies grecques ne sont pas chrétienne. Une philosophie ne mérite le nom de chrétienne que si elle se plie au joug de la foi qui répond a la Révélation. Les philosophies paiennes n’ont été christianisée que parce qu’elles ont été judaisées. Pour que l’eau de la philosophie grecque devint chrétienne, il fallut que des chrétiens la changent en un vin suave, celui de la Révélation.
Organon
La Renaissance a méprisé la philosophie du Moyen Age, et plus particulièrement le syllogisme, qu’elle tenait d’Aristote. On trouve de ces moqueries chez Michel de Montaigne : Le jambon fait boire, or le boire désaltère, donc le jambon désaltère. C’est certes amusant, mais ce n’est pas une critique digne de ce nom, car il suffisait de conclure que le jambon faisait que l’on se désaltère, pour que le syllogisme fût exact.
Si vous vous attardez à lire les drôleries publiées à dessein de railler le syllogisme, vous vous rendez compte de la bêtise de leur auteur. Tenez, Eugène Ionesco, par exemple, qui s’attaque au syllogisme d’Aristote, »Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel« , et le remplace par celui-ci : « Tous les chats sont mortels, or Socrate est mortel, donc Socrate est un chat« . N’importe quel logicien du Moyen Age aurait, l’Organon à dans la main droite, débusqué les sophistes qui usaient de ce genre de syllogisme, puisque la majeure, Les hommes ou les chats sont mortels n’implique en aucune façon que seuls les hommes ou les chats soient mortels. Le raisonnement d’Ionesco est un sophisme. En quoi peut-il donc être retenu comme un argument contre l’usage en bon droit du syllogisme ?
Le rapport qu’entretiennent les philosophes rationalistes avec le syllogisme est passionnel. Comme ils savent que la véracité du syllogisme repose sur la majeure, qui est essentiellement inductive, ils le raillent comme ils peuvent. Et pourtant, le rationalisme n’en a pas contre le syllogisme en soi, mais contre l’induction. Dès que le rationaliste s’est débarrassé de l’induction, ils se lance dans la déduction, et use alors su syllogisme à tout propos, en abuse, à en rendre ses pages indigestes. Il refuse d’affirmer comme la majeure d’Aristote que les tous les hommes sont mortels, il attend de le prouver. Or du point de vue de la déduction pure, il est parfaitement impossible de prouver que les hommes sont mortels. Que tous les hommes soient morts jusqu’à présent ne prouve pas que les hommes sont mortels. Ici, le rationaliste devra donc sacrifier sa méthode pour se fier à l’induction ou à l’expérience, sous peine d’être absurde. Mais il est d’autres cas où il ne le fera pas.
L’induction permet de commencer un raisonnement et la déduction, de le continuer. L’usage en bon droit de la déduction permet de confirmer ou non la justesse de l’induction. Et on peut affirmer sans crainte, que la capacité inductive du philosophe grandit à mesure qu’il déduit. A l’inverse, la philosophie rationaliste serait parfaitement stérile si ses auteurs ne revenaient pas sur leurs principes de temps en temps. Bien raisonner, c’est de première nécessité, afin surtout de pouvoir améliorer sa capacité inductive, car le génie est inductif, pas déductif.
Etablissons cette différence entre le paradoxe d’une part, et le mystère de l’autre, qui est la pâte dans laquelle s’introduit le levain théologique. Le rationalisme est un refus du mystère, dans le sens scientifique et catholique du terme. Pas de mystère chez ces comiques qui prétendent tout prouver, mais beaucoup de paradoxes, forcément inévitables. Là où les catholiques s’en remettent à la Théologie introduisant une dimension verticale les rationalistes restent coincés dans la dimension horizontale. C’est une philosophie résolument naturaliste, et un raisonnement inductif seul aime le mystère.
La racine du paganisme
Pensée détachée :
Comment en finir véritablement avec Dieu ?
Le haïr comme certains athées (je pense aux communistes espagnols), c’est encore croire en Sa présence, vivre avec Lui. (Octavio Paz note dans le Labyrinthe de la solitude, que blasphémer c’est encore croire en Dieu). Notre époque estime non sans raison, que haïr Dieu, c’est encore Lui faire trop d’honneur, que Le prendre en considération, c’est encore trop L’aimer. Elle sait que l’indifférence est plus forte que la haine, car elle permet de sortir du cercle, de rompre le lien qui unit l’homme à Dieu.
Voici tout le paganisme moderne qui est la copie conforme de l’ancien. Le paganisme ancien ignorait la révélation primitive, et se forgeait des idoles en bois. Celui d’aujourd’hui ignore la doctrine catholique et fond des idoles en plastique.
Se fabriquer de faux dieux, et oublier le Vrai, c’est la méthode infaillible pour se débarrasser de Dieu.
Social et religieux
Comme vous le savez, Maurras avait fait son slogan de ces deux mots : Politique d’abord ! Certains pourront trouver là une préoccupation matérialiste, qui se fiche autant que notre monde, de rendre au monde la présence divine.
Dans l’ordre temporel, notre devoir en tant que catholique inclut la christianisation des personnes, contrairement à des Maurras, qui effectivement se fichent pas mal de ces considérations spirituelles. Ce but se réalise à travers les conversions individuelles et la christianisation de l’appareil politique. Or, il n’y a pas d’appareil politique sans un tissu social. C’est donc que pour christianiser l’appareil politique, il faut christianiser la société. Les deux axes du grand œuvre chrétien se rejoignent donc. C’est Social d’abord, que nous devrions adopter comme plan d’action. Dire social d’abord, c’est affirmer la primauté de l’action sociale dans la construction d’un ordre catholique, action qui s’inscrit dans une visée supérieure : le but premier est religieux. Il me semble même que cette primauté du social sur le politique proprement dit doit être affirmée avec d’autant plus de force qu’aujourd’hui il n’y a pratiquement parlant aucune autre alternative. Mais cette visée permet surtout de donner une importance première à la sainteté individuelle, le but de la vie chrétienne.
Je ne résiste pas à l’envie de vous livrer ce court extrait de De la prudence, la plus humaine des vertus de Marcel De Corte :
« On ne fait pas une société avec des individus, mais avec des animaux naturellement politiques, unis préalablement entre eux par le désir de vivre et par l’aspiration de bien vivre, et dont la prudence et l’art institutionnalisent les tendances. La société est antérieure à la personne qui ne peut pratiquement en être que l’effet. Si le christianisme est parvenu à édifier une société de personnes, c’est parce que ces personnes ont reçu la grâce de participer à la vie divine, qui fonde surnaturellement leurs relations mutuelles. En ce sens, l’Eglise est la seule société qui soit postérieure à la personne. Il n’y en a pas d’autre. Il ne peut y en avoir d’autre. Elle seule est ordonnée au salut SURNATUREL de la personne qui possède la grâce. »
Volontarisme chrétien
Peut être ai-je déjà usé de cette expression, ou de celle de volontariste chrétien. Peut-être pas. Mais j’aimerais bien pouvoir en user désormais sans qu’il y ait d’équivoque possible, l’heure est donc venue de vous livrer une courte définition.
Le volontariste chrétien est catholique : de tout son esprit, il adhère aux dogmes de foi de notre Mère l’Eglise. Mais ses mœurs ne sont pas aussi catholiques que son nom le laissait croire.
On pourrait définir la sainteté comme une adéquation parfaite entre la volonté du saint et la volonté de Dieu. Le saint goûte déjà sur la Terre à sa récompense future dans le ciel, il vit dans le présent. Pas comme les jouisseurs modernes et de tous temps, qui confondent plaisir et bonheur, mais comme un homme qui met ses pas dans ceux du Christ. A l’inverse, le volontariste chrétien ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Il l’ignore. Je ne dis pas qu’il ne respecte pas les dix commandements de Dieu, au moins par respect de la loi catholique qui interdit de supposer le mal dans les actions du prochain sauf évidence confirmée par les sens. Non. Je veux dire que ce n’est plus Dieu qui dirige sa vie et ses actions. La volonté de Dieu ne le concerne pas, Dieu ne lui parle plus, et dès lors sa petite conscience Le remplace. Son espérance même n’est plus dans le Christ, elle s’est prostituée en un espoir humain qui réside pour l’essentiel, dans le développement de ses propres actions.
A la limite même, le volontariste chrétien ne se contente plus d’ignorer la volonté divine, mais il l’abaisse à la sienne propre, consommant ainsi parfaitement son iniquité.
Les actions du volontariste ne sont pas marquées du double sceau de la Vérité, qui est en la parole de Dieu, et du Bien qui est dans l’exercice de la volonté divine. N’étant que le résultat des pensées ou désirs humains, faut-il dès lors s’étonner de voir qu’elles ne sont le plus souvent que des actes opportunistes au profit d’un but dont la sainteté n’est franchement pas évidente ? La fin de ses actions n’est plus toujours conforme au Bien, et des moyens indignes se trouvent pouvoir être utilisés à n’importe qu’elle fin. Gustave Thibon note quelque part, que l’expression tomber en dessous de soi est idiote, que tomber en soi, c’est déjà tomber en dessous de tout. L’analyse du volontarisme ne contrarie pas l’axiome de Thibon. Le volontariste chrétien qui fait fi de la volonté divine, se prive du même coup de la noblesse humaine. L’opportunisme l’a remplacée .
Le volontariste en quelque sorte, prétend orgueilleusement savoir mieux que Dieu ce qu’il convient de faire ou non pour Sa gloire d’abord, ce qu’il convient de faire tout court ensuite, et comment il convient de le faire, enfin.
Et assurément, s’il y a un remède au volontarisme chrétien, c’est la lecture de l’Imitation de Jésus Christ. Car le Christ a préféré vivre dans la fidélité, plutôt que de chercher une voie autre que celle que son Père lui traçait pour Se révéler aux hommes.
La scolastique, Aristote et Platon
Les rationalistes ont assez répété que la scolastique s’appuyait sur Aristote comme sur un roc inébranlable, pour qu’il soit presque couramment admis qu’elle n’ait aucun autre appui que celui de l’école aristotélicienne. Un tel mensonge rend plus simple la critique de la scolastique, qui paraît ainsi complètement fermée, et bêtement bornée, accrochée à des doctrines anciennes révolues sur certains points. Un Voltaire ne s’est par exemple pas privé de railler l’attachement aux écrits d’Aristote, dans son Dictionnaire philosophique entre autres écrits, tandis qu’un Goethe s’attachait à démanteler l’Organon et les conceptions du syllogisme de celui que Saint Thomas appelle Le Philosophe dans son Faust.
Certes la scolastique est aristotélicienne. Comme dit l’abbé Aubry dans ses Mélanges de philosophie catholique, « la nature de tout système philosophique dépend de la solution qu’il donne au problème de l’origine de nos connaissances ». La scolastique, reprenant la conception péripatéticienne de l’induction et du syllogisme, mérite donc pleinement le nom d’aristotélicienne. Et vu ce fondement aristotélicien, pour un scolastique « toute la philosophie procède d’Aristote ou doit s’accorder avec elle ». Notons ici la différence d’avec l’averroïsme, qui malgré l’admiration dithyrambique de son initiateur s’écarte d’Aristote en ces points cruciaux.
Néanmoins, il est faux de penser que la scolastique soit exclusivement aristotélicienne. Leibnitz, dans son Systèmes de théologie note plusieurs arguments contre cette opinion commune, repris par Aubry dans ses Mélanges :
Les scolastiques ont toujours affirmé la primauté de la raison pour résoudre les problèmes philosophiques, ce qui les empêchait de prendre pour argent comptant tout écrit du philosophe. Pour la même raison se sont-ils d’ailleurs écartés de l’opinion d’Aristote sur l’éternité du monde, la nécessité des actes divins, et n’ont pas manqué de reprocher à Aristote ses égarements. On leur doit la règle du discernement déterminant que si les écrits des Anciens ont leur valeur, celle-ci ne peut être considéré comme exempte de toute erreur, et sa conséquence logique, à savoir : le devoir de corriger les erreurs des Anciens et d’ajouter à leurs insuffisances.
Les scolastiques se sont à l’occasion servis de Platon pour combattre Aristote. Saint Augustin ayant effectué un grand travail de lecture catholique de la philosophie platonicienne, c’est le néo-platonisme tel qu’enseigné dans les écoles médiévales qui a servi à contrecarrer les erreurs d’Aristote. Aubry cite en exemple la doctrine des « types divins » qui définit que Dieu « porte en Lui les idées de toute chose, et que dans ces idées Il connaît tout ce qui est hors de Lui, et qu’Il n’aurait pas pu créer de rien, s’Il n’avait, de toute eternité, porté dans Son intelligence les idées des choses qu’Il devait créer. »
Aubry poursuit son bref exposé : « Quelques philosophes modernes [l’auteur écrit au XIXème siècle], surtout les Ontologistes, ont pris occasion de cette doctrine, pour soutenir que les scolastiques avaient combattu dans le camp de Platon parce qu’ils ont enseigné, d’après lui, que l’intelligence humaine acquiert la connaissance des choses par l’intuition qu’elle a de ces types qui sont en Dieu. Mais c’est faux car premièrement, Platon n’a jamais enseigné que notre intelligence voit les types des choses en cette vie, et secondement, les scolastiques pour exprimer l’origine de la connaissance humaine, ont suivi non pas Platon, mais Aristote. » Comme quoi, les rationalistes rêvent d’enfermer la scolastique dans un schéma de philosophie issu exclusivement de l’école péripatéticienne ou des écoles platoniciennes.
Conclusion : « Il est donc prouvé que les scolastiques ne se sont pas emprisonnés dans les doctrines d’Aristote, de manière à en être esclaves ; mais qu’ils y ont adhéré de manière à les enrichir de découvertes considérables, à découvrir et à réfuter les erreurs qu’elles couvraient. »